Édito : Mise en pause de l’auto-hébergement
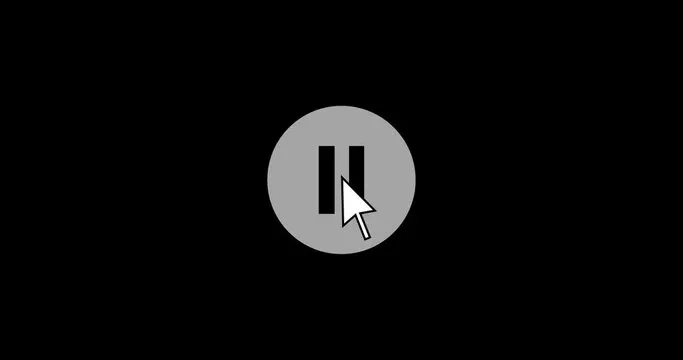
Après des années à bricoler des serveurs, jongler avec des conteneurs et tester tous les services possibles, il est temps de mettre mes expérimentations en pause. Mon abonnement OVH arrive bientôt à échéance, et le nombre de services réellement en ligne ne justifie plus ni la dépense ni le temps investi. Mettre mes serveurs en pause, c’est aussi prendre un moment pour réfléchir à l’impact écologique de ces expériences et à la manière de mieux gérer mon énergie numérique.
Le point de départ
Ce qui a déclenché mon intérêt pour l’auto-hébergement, c’était surtout la mise en place de serveurs de jeux, en particulier Minecraft. Et c’était un prétexte idéal pour améliorer mes connaissances en administration système et applicative.
Le deuxième déclic a été la découverte de Docker, à l’origine de la création de ce site. La possibilité de déployer rapidement plein d’applications a éveillé mon enthousiasme. C’était un terrain de jeu : on déploie, on teste, et si ça ne va pas, on dégage et on recommence, sans altérer le système.
Le nombre d’articles sur ce site le concernant en est la preuve. Dès que je tombais sur une application avec une image Docker, je me lançais dans son installation et sa configuration pour voir si c’était intéressant de l’utiliser au quotidien ou non. Mais passé la curiosité, j’ai fini par me questionner sur le réel intérêt.
Au final, pour qui ?
Je le dis de suite, je ne remets pas en question l’auto-hébergement en lui-même. Il existe vraiment des pépites qui n’ont pas de réel équivalent, en gratuit du moins. Pour une famille, posséder un Nextcloud, un VPN, un outil de téléchargement… C’est réellement pertinent. Mais… Je suis tout seul. Les rares services que j’ai essayé de faire adopter par mes proches… eh bien, ça n’a pas pris.
Finalement, même pour des services précis, il est possible de trouver des applications web qui ont leur propre hébergement. Et ce sont des applications qui tournent en local dans votre navigateur, donc même l’aspect sécurité n’est pas un argument suffisant (Excalidraw, Dillinger, Photopea…)
Le coût ?
Héberger de nombreux services demande un serveur qui tienne la route. Le plus simple reste souvent un hébergement tiers. Pour un serveur raisonnable, comptez environ 10 € par mois (4 cœurs, 4 Go de RAM et 80 Go de disque). Il faut également y ajouter un nom de domaine, ce qui monte le tout à 135€ par an environ. Et vu le peu d’applications encore en service, c’est un peu disproportionné, surtout que le Raspberry Pi qui gère mes accès DNS pourra très bien accueillir ce qui reste. Le débit sera grandement impacté (20 Mo/s, contre 100 Mo/s sur un serveur dédié), mais le ratio coût/performance reste imbattable.
Et l’écologie ?
À cela, il faut évidemment y ajouter le coût écologique. Je sais que certains pourraient penser qu’une VM de plus ou de moins ne changera pas la face du monde, et ils auraient raison. Mais “rien du tout” reste toujours mieux que “pas grand chose”.
Pour être en phase avec mes réflexions actuelles, je dois inclure ce paramètre dans la balance. Faire fonctionner un serveur H24 pour si peu d’utilisation n’est clairement pas pertinent. À force de réfléchir à ma consommation numérique, j’ai fini par voir mon serveur comme une lumière allumée dans une pièce vide.
C’est quoi la suite ?
La fréquence de publication de nouveaux articles sera forcément impactée. Mais il me reste encore beaucoup de sujets que j’aimerais aborder. J’ai encore un Raspberry Pi en service, et j’ai des idées d’articles autour de Linux en général, ainsi que mon utilisation de MacOS.
Et puis cela reste une pause. Rien ne dit que je n’aurai pas plus tard un réel besoin qui m’orientera vers la mise en place d’un nouveau serveur dédié. Mais je tenterai autant que possible de trouver des alternatives, que je partagerai ici si cela me semble pertinent.
On se retrouve bientôt pour de nouveaux sujets.